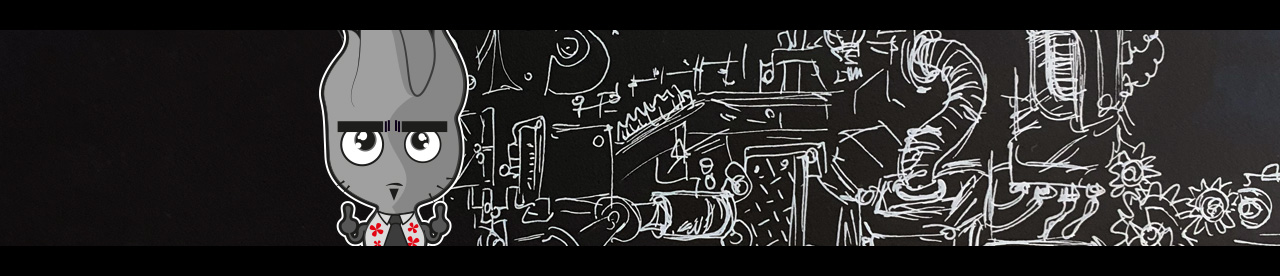Ben attends c'est une forum fondé par des nanas, t'imagines bien qu'on privilégie les mecs pour le weaas tout en préservant notre anonymat sur les photos de ce genre....Grabote a écrit :Quand on illustre le WEAAS VI comme ça
Ça me pique les yeux

C'est sur qu'il faut beaucoup beaucoup de temps, d'attention et surtout une intention ferme pour sortir des schémas qui nous ont imprégnés dans notre enfance.
Chronique du sexisme ordinaire
- TourneLune
- Messages : 13717
- Inscription : mar. 1 févr. 2011 13:50
- Présentation : http://adulte-surdoue.fr/presentations/topic22.html
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : En Aveyron
- Âge : 45
Re: Chronique du sexisme ordinaire
- Chacoucas
- Messages : 1110
- Inscription : jeu. 26 mars 2015 09:12
- Profil : En questionnement
- Test : NON
Re: Chronique du sexisme ordinaire
J'étais tombé là dessus l'autre soir, et je me disais que ça trouverait sa place ici, mais je voyais pas comment le présenter: puisqu'on reparle du sexisme comme n'étant pas spécifiquement propriété masculine, c'est tout trouvé ^^
La conclusion d'un travail a priori de master de 2007 à Genève, sur "les représentations du féminisme", basé sur une enquête par questionnaire chez les étudiant(e)s des filières sciences humaines je crois. Le travail reste donc de peu d'ampleur. (les deux derniers paragraphes étant les plus explicites, si y'a des flemmards ^^)
On parle de 3ème et parfois 4ème vague de féminisme pour désigner les années 80 à 2000 puis l'ère internet et les réseaux sociaux. La tendance étant de ramener le discours à une forme de revendication individuelle, séparée des théories universitaires (ramenant pour la plupart à une critique du concept de genre comme origine des inégalités et des ségrégations entre sexe). En revendiquant le "droit à être femme selon ce que je préfère" c'est donc un discours plus individualiste, qui a pour conséquence notamment de creuser encore plus les inégalités intriquées au sexisme. Et parfois aussi de maintenir des repères qui à une autre époque auraient été considérés sexistes (un documentaire assez amusant et intéressant sur les représentations de la Pin'Up dans les medias et la publicité: la pin'up vintage et ses formes assumées, son pouvoir de séduction étant devenus un symbole de féministes d'aujourd'hui, par exemple, et c'est ainsi que le documentaire le présente, d'ailleurs, sans vraiment relativiser le paradoxe)
Pour exemple, cette étude visant à déterminer l'influence respectivement des idées féministes et des idées racistes dans les positions prises contre le port du voile: https://www.cairn.info/resume.php?ID_AR ... F_251_0084
Le résultat:
Elizabeth Badinter par exemple est entendue dans les medias avec des propos parfois proches de l'obscène (récemment "si les hommes lisent moins, ils sont probablement moins intelligents" dans le cadre de sa fonction de présidente du prix Inter de littérature. La même tenait des discours comme
(pour ne pas sortir la citation de son contexte, elle mettait aussi en garde contre la position victimaire des femmes et la découpe entre mâles bourreaux et femmes victimes, ce qui est probablement intéressant mais ne justifie pas forcément de considérer que le travail est fini... ne serait ce que pour les violences conjugales, les chiffres ne lui donnent pas raison)
Ce problème de représentation médiatique sélectif "était déjà dans les pattes du MLF dans les années 60/70, puisque le mouvement féministe était représenté dans les medias non par des membres du MLF, mais par des hommes invités pour parler des problèmes des femmes.
C'est une des manières dont le sexisme ordinaire se maintient il me semble. Des rapports de force entre dominations différentes qui représentent les notions anti sexisme de manière très différentes, et orientée. Ce qui au final ne fait pas progresser le féminisme dans ses ambitions initiales, masquées par des polémiques diverses et relativement superficielles, détournant l'attention des problèmes de fond.
Edit: si l'aspect théorique ou l'histoire intéresse des gens et que ça colle pas trop avec l'aspect pratique que désirait Grabote initialement, on peut ouvrir un topic ailleurs.
La conclusion d'un travail a priori de master de 2007 à Genève, sur "les représentations du féminisme", basé sur une enquête par questionnaire chez les étudiant(e)s des filières sciences humaines je crois. Le travail reste donc de peu d'ampleur. (les deux derniers paragraphes étant les plus explicites, si y'a des flemmards ^^)
https://www.unige.ch/etudes-genre/files ... emoire.pdfComme dit ci-dessus, selon Toupin, pour adhérer au féminisme, il faut qu’il y ait une
conscience de l’oppression des femmes et une révolte contre celle-ci. Toutefois, en
plus de cette révolte, il faut que cette subordination des femmes puisse être
« dénaturalisée » afin que les rapports de force entre hommes et femmes puissent
être compris comme construits et donc potentiellement à déconstruire. Et, suite à
notre enquête, force est de constater que la conception essentialiste est encore
prégnante. On est loin des « luttes qui reposent sur la reconnaissance des femmes
comme spécifiquement et systématiquement opprimées, l’affirmation que les
relations entre hommes et les femmes ne sont pas inscrites dans la nature mais que
la possibilité politique de leur transformation existe » dont parle FougeyrollasSchwebel
à propos des premiers mouvements féministes du XIXe siècle ! (Gubin et
al., 2004, p.138).
Il est donc important de réfléchir à comment se débarrasser de cette conception pour
pouvoir entamer une remise en question des rapports sociaux de sexe et du
27
patriarcat. Etant donné le cursus universitaire en sciences humaines suivi par les
enquêtées, il est à espérer que leur réflexion autour du « naturel » et de l’ « acquis »
s’affinera et leur ouvrira les yeux sur la dimension sociale des rôles de sexe, en tant
que rôles construits. Il serait ainsi intéressant de pouvoir reproduire une même étude
sur les représentations du féminisme à la fin de leur parcours académique afin de
voir si leurs réponses s’en verraient modifiées. Cette étude longitudinale pourrait
souligner si l’acquisition d’outils de déconstruction permet – ou non – d’envisager les
rapports entre hommes et femmes de manière différente.
Dans la même idée, il serait intéressant de pouvoir ouvrir cette étude à d’autres
groupes sociaux pour étudier si des variables tel que l’âge, le sexe ou la classe
socio-professionnelle ont des incidences sur les représentations que se font les
enquêté-e-s du féminisme et la conception de l’égalité et des rôles des hommes et
des femmes.
Suite à la présente étude, nous pouvons toutefois d’ores et déjà souligner et
regretter, chez nos enquêtées, la méconnaissance du système de rapports sociaux
de sexe qui structure la société. Celle-ci implique un certain déni des rapports de
pouvoir entre femmes et hommes, ainsi que l’acceptation naïve des inégalités ayant
trait à la sphère familiale et domestique.
Pour conclure, nous pouvons avancer que si le féminisme a mauvaise presse dans
les discours ordinaires, c’est en partie parce que ni le caractère systémique des
inégalités ni le rôle social subordonné des femmes ne sont perçus. Le féminisme
perd de ce fait sa raison d’être et est apparenté à quelques revendications
ponctuelles. Et adhérer à un mouvement pour quelques revendications isolées
semble démesuré et peu investi de sens. Certaines enquêtées le font pourtant, mais
sans accompagner leur positionnement féministe par un discours anti-patriarcal ou
militant. Ainsi, si le féminisme du début des années 1970 était révolutionnaire, celui
du début du XXIe siècle semble être individuel et bien timoré.
On parle de 3ème et parfois 4ème vague de féminisme pour désigner les années 80 à 2000 puis l'ère internet et les réseaux sociaux. La tendance étant de ramener le discours à une forme de revendication individuelle, séparée des théories universitaires (ramenant pour la plupart à une critique du concept de genre comme origine des inégalités et des ségrégations entre sexe). En revendiquant le "droit à être femme selon ce que je préfère" c'est donc un discours plus individualiste, qui a pour conséquence notamment de creuser encore plus les inégalités intriquées au sexisme. Et parfois aussi de maintenir des repères qui à une autre époque auraient été considérés sexistes (un documentaire assez amusant et intéressant sur les représentations de la Pin'Up dans les medias et la publicité: la pin'up vintage et ses formes assumées, son pouvoir de séduction étant devenus un symbole de féministes d'aujourd'hui, par exemple, et c'est ainsi que le documentaire le présente, d'ailleurs, sans vraiment relativiser le paradoxe)
Pour exemple, cette étude visant à déterminer l'influence respectivement des idées féministes et des idées racistes dans les positions prises contre le port du voile: https://www.cairn.info/resume.php?ID_AR ... F_251_0084
Le résultat:
Or les medias surreprésentent un féminisme dit "essentialiste" (revendiquant des différences essentielles entre hommes et femmes, maintenant donc les préjugés de genre) et utilisent ce féminisme "modulable" dans diverses polémiques politiques.Les résultats suggèrent également une interaction entre racisme et féminisme. En effet, les personnes qui adoptent des positions à la fois féministes et antiracistes sont celles qui s’opposent le plus à la loi et prennent leur distance par rapport à deux processus producteurs de discrimination : la désignation de l’Autre (ici les Musulman·e·s) comme différent, et la présomption d’une supériorité de la « culture » occidentale.
Les autrices en concluent que pour articuler les luttes féministes et les luttes antiracistes, il faut que le refus du principe de division et de hiérarchie des groupes qui structure la domination s’applique à tous les groupes.
Elizabeth Badinter par exemple est entendue dans les medias avec des propos parfois proches de l'obscène (récemment "si les hommes lisent moins, ils sont probablement moins intelligents" dans le cadre de sa fonction de présidente du prix Inter de littérature. La même tenait des discours comme
pendant qu'une Christine Delphy par exemple, opposée à la loi d'interdiction n'avait pas de représentation médiatique.... (ça n'est pas sa méconnaissance du sujet qui joue puisque Delphy, c'est un peu LE travail de sociologie français du mouvement féministe des années 70 qui a influencé en bonne partie le post structuralisme américain de Butler etc.))Selon Élisabeth Badinter, le combat féministe doit aujourd'hui se concentrer essentiellement sur les populations immigrées ou maghrébines, car selon elle, « depuis longtemps, dans la société française de souche, que ce soit le judaïsme ou le catholicisme, on ne peut pas dire qu’il y ait une oppression des femmes »
(pour ne pas sortir la citation de son contexte, elle mettait aussi en garde contre la position victimaire des femmes et la découpe entre mâles bourreaux et femmes victimes, ce qui est probablement intéressant mais ne justifie pas forcément de considérer que le travail est fini... ne serait ce que pour les violences conjugales, les chiffres ne lui donnent pas raison)
Hors-sujet
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/art ... 55770.html
Un rapide calcul des victimes de violences conjugales montre que les hommes représentent donc 27 % des cas de violence conjugales et 17 % des cas mortels. La formule – tristement consacrée – : « Tous les trois jours, une femme décède sous les coups de son conjoint » peut toutefois son équivalent pour l’autre sexe : « Tous les 14,5 jours, un homme décède sous les coups de sa conjointe ».
C'est une des manières dont le sexisme ordinaire se maintient il me semble. Des rapports de force entre dominations différentes qui représentent les notions anti sexisme de manière très différentes, et orientée. Ce qui au final ne fait pas progresser le féminisme dans ses ambitions initiales, masquées par des polémiques diverses et relativement superficielles, détournant l'attention des problèmes de fond.
Edit: si l'aspect théorique ou l'histoire intéresse des gens et que ça colle pas trop avec l'aspect pratique que désirait Grabote initialement, on peut ouvrir un topic ailleurs.
- Fish
- Poisson Pilote
- Messages : 908
- Inscription : dim. 3 janv. 2016 18:33
- Présentation : viewtopic.php?t=7018
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Âge : 47
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Hors-sujet
Une expérience a été menée avec succès sur des souris: l'extraction du demi caryotype présent dans une ovule et son intégration dans une autre ovule d'une mère porteuse:herbe rouge a écrit :Les hommes ne sont-ils pas autant indispensables que les femmes dans la reproduction?
- ça ne donne nécessairement que des souris femelles (ben oui)
- le brassage génétique est conservé. Les souris ne deviennent pas débiles au bout de 4 générations.
D'après l'émission TV qui en parlait, la seule barrière empêchant d'appliquer la méthode à l'humain était d'ordre éthique.
Moralité de l'histoire, les hommes ne sont désormais utiles que pour le plaisir sexuel et les déménagements, mais plus pour la survie de l'espèce.
- TourneLune
- Messages : 13717
- Inscription : mar. 1 févr. 2011 13:50
- Présentation : http://adulte-surdoue.fr/presentations/topic22.html
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : En Aveyron
- Âge : 45
-
Herbe rouge
- Messages : 128
- Inscription : dim. 25 mars 2012 03:13
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : Bxl
- Âge : 36
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Hors-sujet
-> Fish:
Nice! C'est fascinant comme info, ça me rappelle le clonage. Ca bouleverse tellement de conceptions et de règles établies Tu sais si ça fonctionne sur une seule femme? Si son patrimoine génétique est sélectionné pour être réimplanté dans son propre corps? (Enfin, souris.)
Tu sais si ça fonctionne sur une seule femme? Si son patrimoine génétique est sélectionné pour être réimplanté dans son propre corps? (Enfin, souris.)
Du coup, ici, il y a toujours une association avec une tierce personne (une équipe même) pour procréer. On peut imaginer facilement pleins de biais de création par les intervenants. Dans l'optique de lutte pour sa reproduction, la "lutte" pour le corps des femmes ne serait plus uniquement relatif à la vision d'un mâle à la recherche d'un ventre mais aussi des luttes entre scientifiques, laborantins, riches, politiques, religieux, lobbys conservateurs, économistes, etc. qui pourraient être tentés par une sorte d'eugenisme.
Quel joyeux bordel ça pourrait être quand on voit ce que ça donne avec l'avortement encore aujourd'hui ^^'
(Hey! Ca me fait réaliser que dans un monde que de femme, on aurait pas Trump, Poutine, Erdogan et tutti quanti. Juste Marine et deux trois autres qu'on ne connaît pas encore éventuellement... et encore, j'me demande ce qu'on aurait inventée comme religion pour dominer le monde si ça avait été que des femmes depuis l'apparition de notre espèce
Juste Marine et deux trois autres qu'on ne connaît pas encore éventuellement... et encore, j'me demande ce qu'on aurait inventée comme religion pour dominer le monde si ça avait été que des femmes depuis l'apparition de notre espèce  )
)
Bref... tout ça c'est dans un monde froid et sans amour de toute façon. Actuellement, vous pouvez rajouter à la liste qu'ils nous servent de bouillotte aussi la nuit (bien que je pense que ce soit également un mythe) et ils contribuent à remettre en question notre petite place dans l'univers en tant qu'être à la fois semblable et différent
Nice! C'est fascinant comme info, ça me rappelle le clonage. Ca bouleverse tellement de conceptions et de règles établies
Du coup, ici, il y a toujours une association avec une tierce personne (une équipe même) pour procréer. On peut imaginer facilement pleins de biais de création par les intervenants. Dans l'optique de lutte pour sa reproduction, la "lutte" pour le corps des femmes ne serait plus uniquement relatif à la vision d'un mâle à la recherche d'un ventre mais aussi des luttes entre scientifiques, laborantins, riches, politiques, religieux, lobbys conservateurs, économistes, etc. qui pourraient être tentés par une sorte d'eugenisme.
Quel joyeux bordel ça pourrait être quand on voit ce que ça donne avec l'avortement encore aujourd'hui ^^'
(Hey! Ca me fait réaliser que dans un monde que de femme, on aurait pas Trump, Poutine, Erdogan et tutti quanti.
Bref... tout ça c'est dans un monde froid et sans amour de toute façon. Actuellement, vous pouvez rajouter à la liste qu'ils nous servent de bouillotte aussi la nuit (bien que je pense que ce soit également un mythe) et ils contribuent à remettre en question notre petite place dans l'univers en tant qu'être à la fois semblable et différent
- Fish
- Poisson Pilote
- Messages : 908
- Inscription : dim. 3 janv. 2016 18:33
- Présentation : viewtopic.php?t=7018
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Âge : 47
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Hors-sujet
Le reportage n'en parlait pas. J'imagine que oui, mais le brassage génétique n'est plus conservé.Tu sais si ça fonctionne sur une seule femme?
- Adena
- Messages : 248
- Inscription : ven. 14 août 2015 11:54
- Présentation : [url=http://adulte-surdoue.fr/presentations/presentation-adena-les-memoires-une-jeune-fille-derangee-t6571.html]Neurocosmologiste[/url]
- Profil : Intéressé pour une personne de mon entourage
- Test : NON
- Âge : 35
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Herbe rouge a écrit : (Hey! Ca me fait réaliser que dans un monde que de femme, on aurait pas Trump, Poutine, Erdogan et tutti quanti.Juste Marine et deux trois autres qu'on ne connaît pas encore éventuellement... et encore, j'me demande ce qu'on aurait inventée comme religion pour dominer le monde si ça avait été que des femmes depuis l'apparition de notre espèce
)
Malgré le ton humoristique de l'intervention, ça rejoint une idée très souvent véhiculée voulant que les femmes, si elles étaient au pouvoir, ferait de ce monde un jardin merveilleux et licornesque et qui s'appuie entièrement...sur des clichés sexistes.
S'il y a autant de neurones dans un cerveau que d'étoiles dans la galaxie, on a pas fini d'avoir des idées brillantes !
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Dans le genre "ancrons les clichés", deux jeux strictement identiques pour les enfants, un rose et un bleu, qui distinguent clairement les objectifs de chacun dans la vie : se faire belle et séduire, ou partir à la conquête du monde...
Rêve de princesse
"Ce jeu de parcours et de stratégie, aux belles illustrations, animera des après-midi entre amies. Etre la première à retrouver le prince pour aller au bal, n'est ce pas le rêve de toute petite fille ? Pour cela, il faut récupérer 3 accessoires : une couronne, une robe et une paire de chaussures. Une fois les 3 éléments réunis, il faut chercher le prince qui attend dans l'un des 3 châteaux. Mais le temps presse car la sorcière est aussi à la recherche du prince..."
Rêve de trésor
"Ce jeu de parcours et de stratégie, aux belles illustrations, animera des après-midis entre amis. Etre le premier à trouver le trésor du pirate, voici une quête des plus palpitante ! Pour cela, il faut récupérer 3 objets : la carte au trésor, une boussole et la clef du coffre. Une fois les 3 éléments réunis, il faut chercher le trésor caché sur l'une des trois îles. Mais le temps presse car le pirate recherche aussi son trésor."
Rêve de princesse
"Ce jeu de parcours et de stratégie, aux belles illustrations, animera des après-midi entre amies. Etre la première à retrouver le prince pour aller au bal, n'est ce pas le rêve de toute petite fille ? Pour cela, il faut récupérer 3 accessoires : une couronne, une robe et une paire de chaussures. Une fois les 3 éléments réunis, il faut chercher le prince qui attend dans l'un des 3 châteaux. Mais le temps presse car la sorcière est aussi à la recherche du prince..."
Rêve de trésor
"Ce jeu de parcours et de stratégie, aux belles illustrations, animera des après-midis entre amis. Etre le premier à trouver le trésor du pirate, voici une quête des plus palpitante ! Pour cela, il faut récupérer 3 objets : la carte au trésor, une boussole et la clef du coffre. Une fois les 3 éléments réunis, il faut chercher le trésor caché sur l'une des trois îles. Mais le temps presse car le pirate recherche aussi son trésor."
wonderbra de la recherche Google (c) Miss Souris
-
Herbe rouge
- Messages : 128
- Inscription : dim. 25 mars 2012 03:13
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : Bxl
- Âge : 36
Re: Chronique du sexisme ordinaire
->Adena: tout à fait d'accord, c'est ce que je disais avec ironie 
- Adena
- Messages : 248
- Inscription : ven. 14 août 2015 11:54
- Présentation : [url=http://adulte-surdoue.fr/presentations/presentation-adena-les-memoires-une-jeune-fille-derangee-t6571.html]Neurocosmologiste[/url]
- Profil : Intéressé pour une personne de mon entourage
- Test : NON
- Âge : 35
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Ouf ! Je suis prise en flagrant délit de PPD (personne premier degré) ce qui est, après le sexisme, le pire fléau de l'humanité.
Voyez-donc plutôt ! (pas le chien de Mickey mais le lien ci joint).
Voyez-donc plutôt ! (pas le chien de Mickey mais le lien ci joint).
S'il y a autant de neurones dans un cerveau que d'étoiles dans la galaxie, on a pas fini d'avoir des idées brillantes !
-
Herbe rouge
- Messages : 128
- Inscription : dim. 25 mars 2012 03:13
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : Bxl
- Âge : 36
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Ca arrive à tout le monde ^^ Après, je rappelle en même temps que nous sommes sous la coupe de nombreux parriarcats, c'est peut-être cette partie là qui ta dérangée?
-
Le Renard
- Messages : 1901
- Inscription : sam. 10 mars 2012 22:49
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Âge : 42
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Ce matin je rentre dans le bureau d'un collègue. Y'a un CV posé à côté du clavier. Sur le CV on voit un très beau jeune homme. Premier commentaire de ma part, avant de regarder diplômes ou expériences : "dis donc il a une sacrée belle gueule celui-là".
Si vous le rencontrez, ne lui dites pas que je l'ai pris pour un jambon SVP.
Si vous le rencontrez, ne lui dites pas que je l'ai pris pour un jambon SVP.
- Grabote
- Messages : 3516
- Inscription : mar. 16 sept. 2014 20:08
- Présentation : [url=http://adulte-surdoue.fr/presentations/toc-toc-toc-t5375.html]*[/url]
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : dans un village
- Âge : 55
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Et alors, ça joue plutôt en sa faveur ? ... ou plutôt pas ?
L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. René char
-
Le Renard
- Messages : 1901
- Inscription : sam. 10 mars 2012 22:49
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Âge : 42
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Il a un CV remarquable par ailleurs. Mais s'il l'a gonflé, il n'y a qu'à l'entretien qu'on peut le piéger, et à l'entretien on a forcément le non verbal, et donc l'esthétique, sous le pif.
Honnêtement, tout comme un beau paysage, un beau visage ou un beau corps attirent l'oeil, non ? On trouve plaisir à le contempler. C'est comme ça.
Comme pour les autres instincts : on peut trouver des raisons pour se vautrer dedans, ou bien on peut dire "ok maintenant voyons ce qu'il/elle a dans les tripes, et dans quelle mesure bosser avec lui/elle amènera l'enthousiasme ou la misère". Pour autant, dépasser l'instinct ne veut pas dire prétendre le renier. Et puis, qui n'a jamais cherché sur internet la tête qu'aurait le/la futur(e) collègue ?
Tiens, pour continuer sur les anecdotes à la con. Je m'étais toujours retenu de poster celle-ci. L'autre jour dans une réunion de service au ton sérieux, on évoque les certifications sur certaines technologies. Ces certifications sont bien-sûr délivrées par des organismes de formation extérieurs. Le directeur demande qui n'est pas certifié. Etant l'embauché le plus récent, je lève la main, comme deux ou trois autres sur la vingtaine de présents. Là, une femme qui approche la cinquantaine, avec dans la boîte un pouvoir et une ancienneté bien plus grands que les miens, lance d'un air sans équivoque : "Le Renard il peut venir dans mon bureau se faire certifier quand il veut !"
Est-ce que c'est un problème en l'état ? Et si j'avais été une femme et elle un homme ?
Honnêtement, tout comme un beau paysage, un beau visage ou un beau corps attirent l'oeil, non ? On trouve plaisir à le contempler. C'est comme ça.
Comme pour les autres instincts : on peut trouver des raisons pour se vautrer dedans, ou bien on peut dire "ok maintenant voyons ce qu'il/elle a dans les tripes, et dans quelle mesure bosser avec lui/elle amènera l'enthousiasme ou la misère". Pour autant, dépasser l'instinct ne veut pas dire prétendre le renier. Et puis, qui n'a jamais cherché sur internet la tête qu'aurait le/la futur(e) collègue ?
Tiens, pour continuer sur les anecdotes à la con. Je m'étais toujours retenu de poster celle-ci. L'autre jour dans une réunion de service au ton sérieux, on évoque les certifications sur certaines technologies. Ces certifications sont bien-sûr délivrées par des organismes de formation extérieurs. Le directeur demande qui n'est pas certifié. Etant l'embauché le plus récent, je lève la main, comme deux ou trois autres sur la vingtaine de présents. Là, une femme qui approche la cinquantaine, avec dans la boîte un pouvoir et une ancienneté bien plus grands que les miens, lance d'un air sans équivoque : "Le Renard il peut venir dans mon bureau se faire certifier quand il veut !"
Est-ce que c'est un problème en l'état ? Et si j'avais été une femme et elle un homme ?
-
Herbe rouge
- Messages : 128
- Inscription : dim. 25 mars 2012 03:13
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : Bxl
- Âge : 36
Re: Chronique du sexisme ordinaire
C'est un peu ça la force du sexisme ordinaire, il paraît encore tellement naturel et inoffensif que s'en est peut-être pas en fait.
Par ailleurs, entièrement d'accord pour le beau, le fait de dépasser l'instinct.
Par ailleurs, entièrement d'accord pour le beau, le fait de dépasser l'instinct.
-
Le Renard
- Messages : 1901
- Inscription : sam. 10 mars 2012 22:49
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Âge : 42
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Je crois au contraire que ce n'est justement pas du sexisme. C'est pour ça que je propose ces deux exemples récemment vécus mais ô combien courants. C'est juste l'interférence des instincts de séduction, volontaires ou non, dans les groupes.
La dérive associée s'appelle le harcèlement, et il convient d'avoir du harcèlement des définitions préalables simples, claires et sujettes à l'adhésion du groupe pour allumer le voyant rouge collectif quand elles sont franchies et éviter de laisser ses victimes se faire traîner dans la zone grise qui fait des dégâts. Pour autant, si une dérive existe et qu'elle est assez grave pour mériter un système de défense efficace, je trouve que prétendre amputer le jeu social de la séduction est une solution aussi extrémiste que prétendre interdire de se nourrir sous prétexte que ça peut rendre obèse.
La dérive associée s'appelle le harcèlement, et il convient d'avoir du harcèlement des définitions préalables simples, claires et sujettes à l'adhésion du groupe pour allumer le voyant rouge collectif quand elles sont franchies et éviter de laisser ses victimes se faire traîner dans la zone grise qui fait des dégâts. Pour autant, si une dérive existe et qu'elle est assez grave pour mériter un système de défense efficace, je trouve que prétendre amputer le jeu social de la séduction est une solution aussi extrémiste que prétendre interdire de se nourrir sous prétexte que ça peut rendre obèse.
- Fish
- Poisson Pilote
- Messages : 908
- Inscription : dim. 3 janv. 2016 18:33
- Présentation : viewtopic.php?t=7018
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Âge : 47
Re: Chronique du sexisme ordinaire
On en revient à un point déjà exprimé plus avant: le problème n'est pas qu'une personne face une blague sexiste de temps à autre. Le problème est dans la répétition. Heureusement qu'on peut se permettre des piques sexiste/racistes/homophobes/antisémites/etc. sur le ton de l'humour. Mais certaines catégories de personnes reçoivent des remarques de tous leurs collègues. Chaque collègue y contribue peu, mais l'ensemble des collègues finit par peser. En tant qu'homme, on ne subit généralement pas cette répétition, et une blague sexiste restera très bon enfant.Est-ce que c'est un problème en l'état ? Et si j'avais été une femme et elle un homme ?
- Grabote
- Messages : 3516
- Inscription : mar. 16 sept. 2014 20:08
- Présentation : [url=http://adulte-surdoue.fr/presentations/toc-toc-toc-t5375.html]*[/url]
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : dans un village
- Âge : 55
Re: Chronique du sexisme ordinaire
La dernière anecdote du Renard n'est pas du sexisme mais de la discrimination ...
Quant à ce que la beauté soit toujours un avantage, je ne crois pas et Le Renard aurait pu dire "ça joue en sa défaveur " parce que ce sont des mecs qui recrutent et qu'ils sont jaloux ... Ce qui arrive très souvent entre femmes.
Le sexisme c'est quand il y a une dévalorisation, un mépris, un rapport de force, une hiérarchisation ... du seul fait du sexe de la personne.
Fish post pendant que j'écris, je plussoie son intervention, difficile de se rendre compte de ce que ça fait quand on ne le vit pas au quotidien ...
A ce titre je signale l'excellent film "Les figures de l'ombre", "Hidden figures",
qui retrace l'histoire de trois femmes noires scientifiques travaillant dans les années 60 pour la Nasa ...
Quant à ce que la beauté soit toujours un avantage, je ne crois pas et Le Renard aurait pu dire "ça joue en sa défaveur " parce que ce sont des mecs qui recrutent et qu'ils sont jaloux ... Ce qui arrive très souvent entre femmes.
Le sexisme c'est quand il y a une dévalorisation, un mépris, un rapport de force, une hiérarchisation ... du seul fait du sexe de la personne.
Fish post pendant que j'écris, je plussoie son intervention, difficile de se rendre compte de ce que ça fait quand on ne le vit pas au quotidien ...
A ce titre je signale l'excellent film "Les figures de l'ombre", "Hidden figures",
qui retrace l'histoire de trois femmes noires scientifiques travaillant dans les années 60 pour la Nasa ...
L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. René char
-
Herbe rouge
- Messages : 128
- Inscription : dim. 25 mars 2012 03:13
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : Bxl
- Âge : 36
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Je me risque à une idée:
D'un point de vue féministe, ces situations décrites restent inadéquates et problématiques. Néanmoins, nous ne nous arrêtons pas à cet aspect des choses dans nos vies. En effet, bien d'autres facteurs entrent en ligne de compte comme le besoin de respirer au travail en se divertissant, en faisant de l'humour, en dédramatisant un fil sur un forum en plaçant de l'humour noir ou de l'ironie, on peut parler de ce besoin de séduction dont je perçois ici l'idée qu'on ne puisse plus mettre en place de contexte favorisant la rencontre d'un partenaire par peur d'une vision sacro-sainte d'un féministe tellement revendicateur qu'il deviendrait opprimant, etc.
Bref, du coup comme le disait à maintes reprises Chacoucas, la situation est complexe et au final on revient au besoin de trouver comment faire société ensemble malgré tout ces niveau de perceptions et besoins (pouvoir, différence de point de vue, reproduction, désir, survie, croyances, appartenance à tel ou tel courant de pensée, valeurs, etc.)
D'un point de vue féministe, ces situations décrites restent inadéquates et problématiques. Néanmoins, nous ne nous arrêtons pas à cet aspect des choses dans nos vies. En effet, bien d'autres facteurs entrent en ligne de compte comme le besoin de respirer au travail en se divertissant, en faisant de l'humour, en dédramatisant un fil sur un forum en plaçant de l'humour noir ou de l'ironie, on peut parler de ce besoin de séduction dont je perçois ici l'idée qu'on ne puisse plus mettre en place de contexte favorisant la rencontre d'un partenaire par peur d'une vision sacro-sainte d'un féministe tellement revendicateur qu'il deviendrait opprimant, etc.
Bref, du coup comme le disait à maintes reprises Chacoucas, la situation est complexe et au final on revient au besoin de trouver comment faire société ensemble malgré tout ces niveau de perceptions et besoins (pouvoir, différence de point de vue, reproduction, désir, survie, croyances, appartenance à tel ou tel courant de pensée, valeurs, etc.)
-
Le Renard
- Messages : 1901
- Inscription : sam. 10 mars 2012 22:49
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Âge : 42
Re: Chronique du sexisme ordinaire
On n'en revient nulle-part : je soutiens que ce n'est pas sexiste, et propose de l'observer d'une autre manière.Fish a écrit :On en revient à un point déjà exprimé plus avant: le problème n'est pas qu'une personne face une blague sexiste de temps à autre.
Dans quelle mesure ?Grabote a écrit :La dernière anecdote du Renard n'est pas du sexisme mais de la discrimination ...
C'est clair. Et donc, dans un sens ou dans un autre, ça peut jouer. Mais ce n'était pas là l'objet, je crois, de l'agacement exprimé par quelqu'un plus haut. L'agacement portait sur le fait même de s'intéresser à l'aspect d'une candidate.Grabote a écrit :Quant à ce que la beauté soit toujours un avantage, je ne crois pas
J'adhère. Et je remets donc d'autant plus en question l'utilisation de ce mot dans les situations dont on est en train de parler.Grabote a écrit :Le sexisme c'est quand il y a une dévalorisation, un mépris, un rapport de force, une hiérarchisation ... du seul fait du sexe de la personne.
Je trouve qu'on fait un mélange qui tient mal là, et qu'on devrait prendre le temps de re-distinguer d'une part l'effet de la répétition d'un truc bénin, et d'autre part l'effet d'un rapport de force ou d'une discrimination effective. Tu sais Grabote j'ai grandi en entendant, à une époque qui a duré six ans, presque tous les jours des allusions sur les boches et les nazis (notamment et surtout par des adultes alors que j'étais moi-même enfant) et en entendant mes phrases répétées avec l'accent de papa Schultz, mais tout le monde s'en fout parce que je ne fais pas partie d'une "communauté" qui se médiatise. Je pense que je sais ce que fait la répétition, même si ça ne cadre pas forcément avec ta manière de classer les gens a priori.Grabote a écrit :Fish post pendant que j'écris, je plussoie son intervention, difficile de se rendre compte de ce que ça fait quand on ne le vit pas au quotidien ...
Autre expérience : j'ai commencé mon précédent métier en étant pendant trois mois un sujet pour un instructeur qui avait des droits de monarque absolu sur notre carrière et sur notre emploi du temps h24, qui pouvait nous faire ou nous défaire et qui, se trouve-t-il, était un homosexuel notoire qui me faisait des sous-entendus plusieurs fois par jour. Je maintiens que ce n'était ni du sexisme ni du harcèlement, dans la mesure où cet instructeur faisait parfaitement bien la différence entre d'une part l'expression de son désir pour moi, et d'autre part l'utilisation possible de son pouvoir sur moi.
Pour tout dire ça me faisait marrer, et je m'entendais très bien avec le gars, dont j'admirais l'impressionnante compétence opérationnelle et pédagogique.
- Chacoucas
- Messages : 1110
- Inscription : jeu. 26 mars 2015 09:12
- Profil : En questionnement
- Test : NON
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Pour l'idée de "répétition", je trouve cette vidéo assez courte et explicite.
Sauf qu'il faut avoir FB... dsl
Edit 1: Pour soutenir dans la mesure du raisonnable l'idée de Renard, si on suit un peu les raisonnements de Butler, le but pour dépasser la ségrégation liée au genre c'est de jouer une subversion du genre.
Accessoirement, les travaux sur la censure montrent majoritairement que la censure et le politiquement correct amènent en fait à des effets inverses à ceux espérés (ça stratifie des tabous et ségrégations qui continuent à exister et s'exprimer de manière moins évidente et visible). Et ça n'entraine pas non plus une "fin" de la séduction ou de la sexualisation des rapports humains en soi.
Maintenant ça ne répond pas à tout, et par phénomène de conformisme (au sens dynamique sociale, ça implique une soumission et une adoption des attitudes et opinions) ça me semble évident qu'une sexualisation trop systématique des rapports supposés "officiels" et "institutionnels" pose de mega problèmes.
Et si ma tendance est à attirer l'attention sur la ségrégation positive sur un individu, le conformisme lui va facilement jouer sur les classifications et ramener à un sexisme.
Ca dépend des limites qu'on donne au problème je crois.
Edit 2: Je me souviens d'un prof de fac qui (on était en Lettres modernes: les filles sont (très) largement majoritaires) était clairement dans de la séduction ou dans un renforcement des signaux de séduction par rapport aux (plus jolies et libérées et respectueuses) filles de la classe.
C'était évident, ça amusait tout le monde (les concernées les premières), et ça n'a jamais dérivé en accusations graveleuses ou violentes à l'encontre du prof (qui pourtant, par plaisir revendiqué de fumer sa pipe finissait par faire cours dans la cour au groupe d'élèves (au féminin en majorité) regroupé autour de lui. Tant pis pour ceux qui pensaient que ça se passait que dans la salle.
Bah j'imagine que la même chose dans une concentration démographique plus vaste aurait posé problème. Que la même chose à notre époque plus influencée par un féminisme made in networks tirant sur la guerre entre sexes et la stratification de préjugés (ça par contre c'est pas nouveau ni un progrès...), ça aurait posé problème aussi.
A ma connaissance les seuls "avantages" qui en ont été retirés sont des conseils et discussions personnalisés et éventuellement un livre ou deux offerts au fil des échanges. Je précise pour souligner le basculement de perceptions possibles selon les représentations majoritaires: offrir des livres à des étudiants c'est 1 du favoritisme, 2 si on sexualise la relation de la prostitution.
Ca ne veut pas dire que ce cas à mon sens nullement négatif soit majoritaire et le but est pas de minoriser des problèmes posés plus globalement.
Sauf qu'il faut avoir FB... dsl
Edit 1: Pour soutenir dans la mesure du raisonnable l'idée de Renard, si on suit un peu les raisonnements de Butler, le but pour dépasser la ségrégation liée au genre c'est de jouer une subversion du genre.
Accessoirement, les travaux sur la censure montrent majoritairement que la censure et le politiquement correct amènent en fait à des effets inverses à ceux espérés (ça stratifie des tabous et ségrégations qui continuent à exister et s'exprimer de manière moins évidente et visible). Et ça n'entraine pas non plus une "fin" de la séduction ou de la sexualisation des rapports humains en soi.
Maintenant ça ne répond pas à tout, et par phénomène de conformisme (au sens dynamique sociale, ça implique une soumission et une adoption des attitudes et opinions) ça me semble évident qu'une sexualisation trop systématique des rapports supposés "officiels" et "institutionnels" pose de mega problèmes.
Et si ma tendance est à attirer l'attention sur la ségrégation positive sur un individu, le conformisme lui va facilement jouer sur les classifications et ramener à un sexisme.
Ca dépend des limites qu'on donne au problème je crois.
Edit 2: Je me souviens d'un prof de fac qui (on était en Lettres modernes: les filles sont (très) largement majoritaires) était clairement dans de la séduction ou dans un renforcement des signaux de séduction par rapport aux (plus jolies et libérées et respectueuses) filles de la classe.
C'était évident, ça amusait tout le monde (les concernées les premières), et ça n'a jamais dérivé en accusations graveleuses ou violentes à l'encontre du prof (qui pourtant, par plaisir revendiqué de fumer sa pipe finissait par faire cours dans la cour au groupe d'élèves (au féminin en majorité) regroupé autour de lui. Tant pis pour ceux qui pensaient que ça se passait que dans la salle.
Bah j'imagine que la même chose dans une concentration démographique plus vaste aurait posé problème. Que la même chose à notre époque plus influencée par un féminisme made in networks tirant sur la guerre entre sexes et la stratification de préjugés (ça par contre c'est pas nouveau ni un progrès...), ça aurait posé problème aussi.
A ma connaissance les seuls "avantages" qui en ont été retirés sont des conseils et discussions personnalisés et éventuellement un livre ou deux offerts au fil des échanges. Je précise pour souligner le basculement de perceptions possibles selon les représentations majoritaires: offrir des livres à des étudiants c'est 1 du favoritisme, 2 si on sexualise la relation de la prostitution.
Ca ne veut pas dire que ce cas à mon sens nullement négatif soit majoritaire et le but est pas de minoriser des problèmes posés plus globalement.
-
Le Renard
- Messages : 1901
- Inscription : sam. 10 mars 2012 22:49
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Âge : 42
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Ta vidéo marche aussi sans compte FB.  Cette femme a une répartie splendide !
Cette femme a une répartie splendide !
Le cas du harcèlement de rue n'est pour moi pas un cas de répétition d'une truc bénin, et le mot harcèlement a bien toute sa place. En effet venant d'inconnus, souvent physiquement dominants, hors d'un cadre protecteur, on introduit la notion de pouvoir et de menace, et on n'est plus du tout dans une "interférence de la séduction".
(Edit 1 : rédigé avant les Edit 1 et 2 de Chacoucas)
Le cas du harcèlement de rue n'est pour moi pas un cas de répétition d'une truc bénin, et le mot harcèlement a bien toute sa place. En effet venant d'inconnus, souvent physiquement dominants, hors d'un cadre protecteur, on introduit la notion de pouvoir et de menace, et on n'est plus du tout dans une "interférence de la séduction".
(Edit 1 : rédigé avant les Edit 1 et 2 de Chacoucas)
- Fish
- Poisson Pilote
- Messages : 908
- Inscription : dim. 3 janv. 2016 18:33
- Présentation : viewtopic.php?t=7018
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Âge : 47
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Ce que j’essaie de dire (mais visiblement pas bien), c'est qu'on peut parfaitement avoir:On n'en revient nulle-part : je soutiens que ce n'est pas sexiste, et propose de l'observer d'une autre manière.
- une blague sexiste à l'égard d'un homme qui ne sera pas prise mal, parce qu'elle est peu fréquente
- la même blague sexiste vis-à-vis d'une femme, émise par une personne qui n'a rien d'un gros lourd, mais qui a la même attitude que tant d'autres. Et la répétition de ce genre de blague sans mauvaise intention peut user.
On ne peut pas invoquer la symétrie en inversant les rôles de l'homme et de la femme, parce que la fréquence n'est pas symétrique. Une blague faite vis-à-vis d'un homme n'est ni plus ni moins sexiste que la même vis-à-vis d'une femme. Et il faut que des blagues occasionnelles soient tolérables, sans quoi on rentre dans le puritanisme et politiquement correct. Mais une blague vis-à-vis d'un homme sera moins sexiste que 10 blagues vis-à-vis d'une femme.
C'est le genre de chose qui m'a paru flagrant quand j'ai bossé en mammographie. C'est un univers très féminisé. Un signe fort de l'égalité des sexes est que les femmes occupent des postes à responsabilités. Ce n'est pas qu'une égalité numérique avec des ingénieurs hommes d'un coté et leurs assistantes de l'autre. Les hommes en mammographie font bien moins de ces petites blagues sexistes. A la place, il y a d'autres blagues, ou d'autres discussions.
Ce n'est pas un univers politiquement correct. Le comportement des hommes se modifie spontanément et sans frustration. Jamais je ne me suis dit "ah mince, j'aurais bien une blague sexiste à sortir, mais je vais passer pour un lourd alors je la garde pour moi". Ça, ça serait du politiquement correct. Mais non, ça n'arrive pas, ça vient spontanément. Faire des blagues misogynes, accrocher une pin-up sur la porte du casier, partager la lecture de l’Équipe autour du café, évoquer ses emmerdes avec sa moto et le prix que ça coûte, c'est se conformer à un rôle masculin qui a tendance à prendre toute la place. Mais il n'y a pas de "nature masculine" qui pousse les hommes à parler sport ou mécanique automobile. Quand la place des femmes est plus importante, les centres d'intérêt des hommes se modifient aussi sans qu'ils ne fassent d'efforts particuliers en ce sens, et le volume des petites blagues misogynes baisse.
-
Herbe rouge
- Messages : 128
- Inscription : dim. 25 mars 2012 03:13
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : Bxl
- Âge : 36
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Petit rappel suite à l'intervention de Grabote 
Définition tirée du Larousse: "sexisme: n.m. Attitude discriminatoire fondée sur le sexe."
Définition tirée du Larousse: "sexisme: n.m. Attitude discriminatoire fondée sur le sexe."
- Grabote
- Messages : 3516
- Inscription : mar. 16 sept. 2014 20:08
- Présentation : [url=http://adulte-surdoue.fr/presentations/toc-toc-toc-t5375.html]*[/url]
- Profil : Bilan +
- Test : WAIS
- Localisation : dans un village
- Âge : 55
Re: Chronique du sexisme ordinaire
Je ne pensais pas particulièrement à toi en appuyant sur la difficulté de se rendre compte de l'effet de répétition.Le Renard a écrit :Je pense que je sais ce que fait la répétition, même si ça ne cadre pas forcément avec ta manière de classer les gens a priori.
Je crois que tu te trompes sur ma façon de classer les gens dont toi.
Moi par exemple, je sais ce que ça fait de devoir en faire plus que d'autre professionnellement pour être un minimum respectée et prise au sérieux, d'assumer plus de taches ménagères et de donner plus de temps et d'attention éducative que le père de ma fille, je sais ce que ça fait de subir un viol conjugal, je sais ce que ça fait d'être moins bien payé (toutes choses égales par ailleurs) etc ... mais je ne sais pas ce que ça fait de subir les vexations quotidiennes que vivent les femmes noires (par exemple) dans notre pays, qui cumulent malheureusement, sexisme, racisme et souvent classisme :-(
Récemment, dans un commerce, je suis tranquillement passée devant une femme noire qui faisait la queue à la caisse.
Il y a eu un flottement dans la queue et je me suis imposée tout naturellement, sans même y penser, sans même la voir vraiment
ET puis en sortant , j'ai eu un sursaut de conscience, j'ai réalisé ce qui venait de se passer. J'ai eu honte.
J'ai senti toute cette attitude de privilégiée que je peux avoir parfois en tant que femme blanche pas trop moche et bénéficiant d'un certain capital culturel et social.
J'ai attendu qu'elle sorte pour m'excuser.
Depuis, je suis plus vigilante.
Ps: j'avoue que j'ai un peu pris le train en marche sans prendre le temps de lire les messages précédents que je ne connaissais pas.
Pss: c'est discriminatoire pas sur le sexe mais sur l'apparence physique. T'es beau gosse, ça sera plus facile pour toi ( en tous cas c'est ce que j'ai compris de ton histoire) les plus moches suivront la procédure.
L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. René char